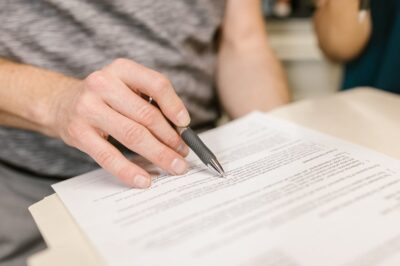Tour d’horizon sur la journée de solidarité

Avez-vous déjà entendu parler de la journée de solidarité ? Peut-être que votre entreprise vous a déjà prévenu de la tenue de cette journée ou que vous en êtes l’employeur ? Dans tous les cas, un avocat du droit de travail peut vous expliquer ce qu’elle signifie ainsi que vos droits. En attendant, découvrez ce qu’il y a à savoir sur la journée de solidarité.

En quoi consiste la journée de la solidarité ?
Chaque année, les entreprises sont tenues de réaliser une journée de solidarité. Les employeurs et les salariés sont concernés par cette disposition. Elle vise à favoriser l’indépendance des personnes âgées et à mobilité réduite. Sa définition permet d’en comprendre davantage :
La journée de solidarité est mise en place pour financer les projets permettant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Les salariés travaillent normalement sans être rémunérés. Les gains ainsi que la contribution solidarité autonomie venant des employeurs sont versés en faveur de ces importantes actions.
Ainsi, la journée de solidarité se traduit comme un jour de travail normal pour les employés. En d’autres termes, ils travaillent durant sept heures, mais sans rémunération. Elle est planifiée pendant un jour chômé comme le lundi de Pâques ou le 1er mai. Elle peut aussi se tenir lors d’un jour de repos décidé à partir d’un accord collectif lié avec l’aménagement du temps de travail. Les entreprises peuvent également décider d’une date spécifique du moment qu’elle permet la réalisation d’heures supplémentaires de sept heures.
Pour cette année, beaucoup d’entreprises ont décidé d’effectuer la journée de solidarité lundi de Pentecôte 24 mai 2021.
Journée de la solidarité : qu’en est-il du paiement ?
Même si le jour choisi est férié et non travaillé dans l’entreprise, il est possible que l’employeur l’ait choisi comme journée de solidarité. Dans ce cas, normalement, les salariés participant à la journée de la solidarité sont tenus de travailler et ne sont pas rémunérés. Cependant, il existe des exceptions et certaines règles qu’il faut savoir. En effet, les employés mensualisés ne sont pas payés s’ils sont soumis à un contrat de travail à plein temps et que les heures supplémentaires ne dépassent pas sept heures. Toutefois, il est possible de faire un choix. Ils peuvent opter pour une perte de journée de repos ou RTT au lieu de la rémunération. En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la durée de travail de sept heures est déduite proportionnellement sur celle prévue par le contrat de travail initial. Dans les deux cas, les heures de travail réalisées durant la journée de la solidarité ne doivent pas impacter le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires. Cette règle vaut aussi pour les travailleurs mensualisés à temps partiel ou les intérimaires.
Point important :
En contrepartie de la journée de la solidarité, les salariés n’ont pas le droit de demander un jour de repos. Il existe aussi des rémunérations qui sont déterminées en fonction du nombre annuel de jours de travail. Dans ce cas-ci, la limite des heures supplémentaires à réaliser durant cette journée doit correspondre à la valeur d’une journée de travail. Pour finir, le cas des salariés non mensualisés comme les intérimaires constitue une exception. Ils doivent participer à cette action, mais ils sont rémunérés pour le travail accompli.
Journée de la solidarité : refus de participation
Les principes de refus concernent généralement les salariés du secteur du privé. Généralement, ils ne peuvent pas refuser de participer à une journée de solidarité. Pour eux, celle-ci est considérée comme un véritable jour de travail. Ils doivent ainsi faire acte de présence à la date choisie. Ils risquent d’être sanctionnés de diverses manières en cas d’absence ou de refus de participation comme le montre la liste suivante :
- L’employeur peut appliquer une retenue sur salaire sur les heures de travail qui auraient dû être effectuées durant la journée de solidarité.
- Il peut également opter pour d’autres sanctions disciplinaires en fonction du profil de l’employé. Le licenciement peut même être envisagé dans certains cas. En revanche, l’employeur ne peut pas utiliser le refus de la date de la journée de solidarité si le salarié est retenu par des obligations familiales ou un suivi d’enseignement scolaire ou universitaire. D’ailleurs, les employés à temps partiel ont le droit de refuser de participer à la journée de solidarité si l’un de ces cas se présente.
Si le salarié ne souhaite pas participer à cette journée, il existe tout de même une échappatoire. Il peut poser une demande de congé payé ou de jour RTT. La suite dépend totalement de l’employeur puisqu’il est libre de la refuser ou de l’accepter. Il est également possible de fractionner en heures la journée de solidarité. Un salarié à temps complet doit juste remplir les sept heures supplémentaires prévues.
Bon à savoir :
Les employeurs n’ont pas le droit d’obliger les salariés à prendre un jour de congé payé durant la journée de solidarité.
Journée de la solidarité : le cas d’un salarié qui change d’employeur
Au cours d’une année, il arrive fréquemment qu’un salarié change d’emploi. Ce changement de situation implique un nouvel employeur, de nouvelles conditions de travail et cotisations. Souvent, l’employé concerné se demande s’il doit effectuer deux journées de solidarité. Selon les réglementations en vigueur, un salarié doit cotiser une fois seulement pour cette journée destinée au financement de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Ainsi, une journée de solidarité réalisée vaut pour toute l’année. En d’autres termes, le nouveau salarié ne doit pas participer à cette journée s’il en a déjà effectué dans son ancien travail. En revanche, le nouvel employeur peut demander sa participation sans le forcer. S’il accepte, il doit être rémunéré pour les heures supplémentaires réalisées. Il doit aussi bénéficier obligatoirement d’une contrepartie prenant la forme de repos. Dans le cas d’un refus, son acte ne peut être perçu comme une insubordination. Ainsi, il ne peut être sanctionné ni licencié.
Pour résumer, la journée de solidarité destinée à aider les personnes âgées et handicapées concerne les employeurs et les salariés. En cas de refus par un employé ou d’abus de la part d’un employeur, vous pouvez contacter un avocat du droit du travail pour découvrir vos droits.
Besoin d’un avocat ?
Trouvez un avocat simplement et sans inscription sur la plateforme Justifit