Délit : les sanctions et peines d’emprisonnement prévues par le code pénal

Les délits sont les infractions pénales jugées devant les tribunaux correctionnels. Ce sont des infractions moins graves que les crimes, mais plus graves que les contraventions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les délits et les sanctions prévues par le code pénal. Vous pouvez aussi solliciter l’aide d’un avocat spécialisé en droit pénal pour plus d’informations.
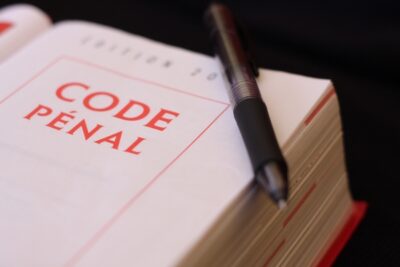
Délits : définition juridique
Dans le droit pénal français, il existe trois catégories d’infractions : les crimes, les délits et les contraventions (article 111.1 du Code pénal).
Les délits sont des infractions d’une gravité intermédiaire, c’est-à-dire moins graves que les crimes mais plus graves que les contraventions.
Le régime des délits, comme celui des crimes, est du ressort de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution de 1958 (Constitution de la Vème République).
Le jugement des délits est du ressort des tribunaux correctionnels. Exemples de délits : le vol, le harcèlement moral, la fraude fiscale, la corruption, les violences graves, etc.
Délits : les sanctions prévues par la loi pour cette infraction
A la différence des contraventions, les délits peuvent être sanctionnés par une peine d’emprisonnement.
La durée maximale de la peine d’emprisonnement, pour un délit, est de 10 ans. A titre de comparaison, la peine d’emprisonnement pour un crime est comprise entre 15 ans et la perpétuité.
Mais l’emprisonnement n’est pas l’unique peine possible en cas de délits. Au contraire, le régime des délits se caractérise par la grande diversité des sanctions possibles (appelées sanctions correctionnelles).
Le délit peut être sanctionné, outre la peine d’emprisonnement, par :
- Une amende d’un montant égal ou supérieur à 3 750 euros pour une personne physique, ou égal ou supérieur à 18 750 euros pour une personne morale (une entreprise par exemple).
- Une peine de jour-amende : le délinquant est condamné à payer une somme d’argent par jour pendant une période de temps fixée.
- Les travaux d’intérêt général (TIG), qui correspondent à des travaux non rémunérés.
- Le stage de citoyenneté.
- Les peines privatives de liberté. Exemples : annulation du permis de conduire, interdiction de porter une arme, interdiction de fréquenter certaines personnes, etc.
- Les peines complémentaires : immobilisation du véhicule, fermeture d’un établissement, confiscation d’un animal, retrait d’un droit, etc.
- Les dommages et intérêts (si la victime de l’infraction se porte partie civile). Exemple : versement d’une somme d’argent.
Correctionnalisation et criminalisation : définitions
Un délit peut être transformé en crime. Dans ce cas, on parle de criminalisation. Par exemple, un vol, qui est normalement un délit, pourra être transformé en crime en cas de violences graves commises sur la victime du vol.
A l’inverse, un crime peut être transformé en délit. On parle alors de correctionnalisation. Il y a correctionnalisation par exemple lorsqu’un juge décide qu’un homicide initialement présumé volontaire était en réalité involontaire.
Comment un avocat peut-il aider lorsque quelqu’un est accusé d’avoir commis un délit ?
Un avocat spécialisé en droit pénal peut apporter son aide à une personne accusée d’un délit de diverses manières, adaptées à la nature de l’infraction, à la juridiction concernée et aux détails particuliers de l’affaire. Voici quelques exemples de la manière dont un avocat peut être d’une utilité précieuse :
- Représentation légale : L’avocat peut représenter l’individu devant les tribunaux et plaider sa cause. Cela peut inclure la négociation d’accords de plaider-coupable ou de peines réduites, la défense de l’individu lors d’un procès ou l’appel de la condamnation.
- Protection des droits : L’avocat veillera à ce que les droits constitutionnels de l’individu soient respectés tout au long du processus judiciaire, y compris le droit à un avocat, le droit de rester silencieux et le droit à un procès équitable.
- Enquête et collecte de preuves : L’avocat peut mener des enquêtes pour rassembler des preuves, interroger des témoins, examiner les éléments à charge et à décharge, et préparer une défense solide.
- Plaidoyer : L’avocat peut plaider en faveur de l’individu pour obtenir une peine moins sévère, une probation, une libération conditionnelle ou d’autres mesures alternatives à la prison, selon les circonstances.
- Réduction de peine : Dans certains cas, un avocat peut travailler pour réduire la peine ou aider l’individu à obtenir une libération anticipée par le biais de programmes de réhabilitation ou de réinsertion.
- Recours en appel : Si l’individu est condamné, l’avocat peut engager des procédures d’appel pour contester la décision de la cour ou la sentence.
En conclusion, la définition juridique des délits, leurs sanctions possibles, ainsi que les processus de correctionnalisation et de criminalisation montrent à quel point la compréhension du droit pénal est complexe et nuancée. Lorsqu’une personne est accusée d’avoir commis un délit, faire appel à un avocat spécialisé en droit pénal devient essentiel. Son rôle est vital pour assurer un traitement équitable de la personne accusée par la justice et examiner toutes les voies légales afin d’obtenir la meilleure résolution possible dans un contexte juridique compliqué.
Besoin d’un avocat ?
Trouvez un avocat simplement et sans inscription sur la plateforme Justifit
















